Washington avance des arguments de poids pour justifier l'intervention américaine. Nous avons déjà entendu toutes ces arguties.
Source : The Intercept, Alain Stephens
Traduit par les lecteurs du site Les-Crises
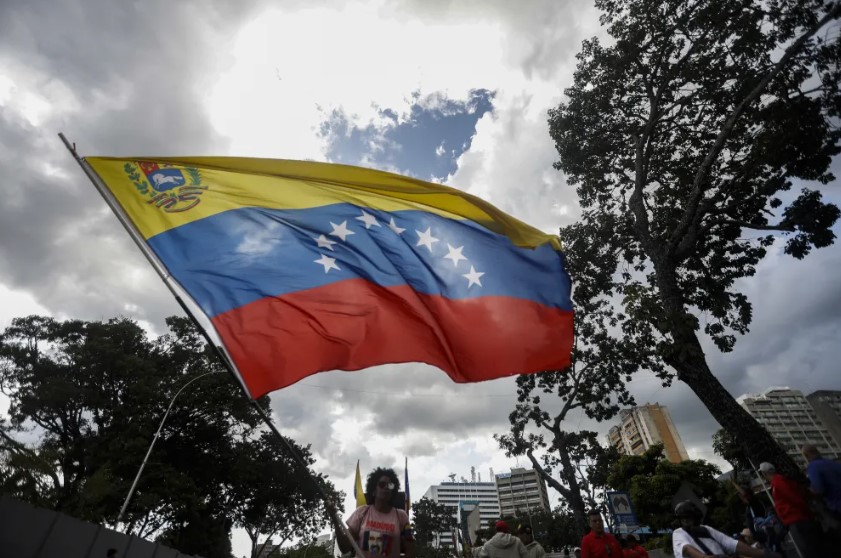
Photo : Pedro Mattey/Anadolu via Getty Images
Alain Stephens est un journaliste d'investigation qui couvre la violence armée, le trafic d'armes et l'application de la loi fédérale.
Les États-Unis accumulent des forces au large des côtes vénézuéliennes. Des navires de guerre, des détachements de Marines et des avions de surveillance affluent dans les Caraïbes sous le prétexte « d'opérations antidrogue. » Les responsables militaires ont présenté à Donald Trump divers plans d'action pour des opérations potentielles. Le président américain lie ouvertement Nicolás Maduro aux réseaux narco-terroristes et aux structures des cartels, tout en brandissant à la fois la perspective de « pourparlers » et la menace d'une intervention militaire. Tout cela conduit à couronner Maduro et son gouvernement comme les prochains « terroristes » numéro un des États-Unis, une étiquette magique tirée d'un scénario de film qui signifie que les bombes peuvent commencer à être préparées.
Vient ensuite le prologue médiatique : un éditorial de Bret Stephens publié lundi dans le New York Times, qui assure aux lecteurs dans « The Case for Overthrowing Maduro » (Le dossier pour renverser Maduro) que tout cela est modeste, calibré, voire raisonnable.
« La question sérieuse est de savoir si une intervention américaine aggraverait encore la situation », écrit Stephens. « Intervention signifie guerre, et guerre signifie mort. [...] La loi des conséquences imprévues est irrévocable. »
L'argument de la chronique est simple : détendez-vous. Ce n'est pas l'Irak, un conflit dans lequel Stephens a contribué à nous entraîner et pour lequel il a fièrement déclaré en 2023, deux décennies plus tard, qu'il ne regrettait pas d'avoir soutenu la guerre.
« Il existe également des différences importantes entre le Venezuela et l'Irak ou la Libye » poursuit-il. « Parmi celles-ci, on peut citer la réticence manifeste de Trump à envoyer des troupes américaines sur le terrain pour une période prolongée. Et le fait que nous pouvons tirer les leçons de nos erreurs passées. »
Selon Stephens, le Venezuela justifie une intervention contre les criminels dans un État défaillant. Maduro est corrompu, la menace est réelle, et les mesures prises par Trump ne sont pas les premiers coups de feu d'une guerre, mais l'application nécessaire d'une puissance modérée. C'est un argument que les Américains ont déjà entendu. Et il est aussi familier que le matériel militaire qui se dirige actuellement vers Caracas.
Tout ce qui est ancien redevient nouveau
Les échos de l'Irak sont partout : la certitude morale, l'insistance sur une mission restreinte, les lois étirées pour s'adapter à la force, la classe journalistique poussant les lecteurs vers l'idée d'une escalade. Le Times s'appuie sur cette posture : la confiance intellectuelle que si un dictateur est suffisamment cruel, si son pays est suffisamment chaotique, alors la puissance de feu américaine est non seulement justifiée, mais prudente et même morale.
Mais prenons un peu de recul. Il n'y a rien de modeste dans le fait qu'un groupe aéronaval, comprenant le plus grand navire de guerre au monde, se mette en position près d'un pays que les États-Unis ont passé des années à sanctionner, à isoler et à tenter de renverser politiquement. Il n'y a rien de modeste dans le fait d'intégrer le « narco-terrorisme » dans le discours politique, une étiquette qui permet commodément de contourner l'autorisation du Congrès. Et il n'y a rien de rassurant à ce que le président déclare aux journalistes qu'il est ouvert au « dialogue », tout en laissant entendre qu'il ripostera si Maduro ne cède pas.
Il ne s'agit pas d'une application de la loi. Il s'agit d'une politique coercitive soutenue par la puissance militaire. Et lorsque la presse répète sans critique le discours de l'administration, l'escalade devient plus facile à accepter.
Nous avons déjà vu ce film
L'Irak aurait dû marquer la fin de l'innocence dans la pensée américaine en matière de politique étrangère. Nous avons renversé Saddam Hussein, ce qui a suivi n'était pas la libération, mais un vide. Le pouvoir n'est pas passé aux institutions démocratiques, il s'est dispersé, provoquant une insurrection, un effondrement sectaire et une dette nationale que les Américains ne rembourseront jamais.
Nous avons déjà vu cette chorégraphie auparavant. En 2002, le Washington Post assurait à ses lecteurs que renverser Saddam et envahir l'Irak serait - je ne plaisante pas - « un jeu d'enfant. » Mais le New York Times a une fois de plus montré la voie : un article de 2001 intitulé « Les États-Unis doivent frapper Saddam Hussein » présentait Saddam comme animé par « une haine intensifiée par une culture tribale de vendetta », et affirmait que la guerre préventive était un devoir moral pour les États-Unis. En 2003, le Times dressait le portrait des « libéraux en faveur de la guerre », faisant passer l'idée que même les pacifistes de longue date étaient prêts à se rallier à cette cause.
Et puis il y a eu le coup de grâce : en septembre 2002, un article en première page affirmait que l'accès de l'Irak à des « tubes d'aluminium » intensifiait « sa quête de composants pour fabriquer des bombes », une affirmation qui est devenue l'un des arguments les plus puissants de l'administration Bush, même si elle s'est effondrée sous le poids des critiques. Moins de deux ans plus tard, le Times a discrètement admis ce que le pays savait déjà : sa couverture « n'avait pas été aussi rigoureuse qu'elle aurait dû l'être » - des excuses qui n'ont rien changé pour les morts, les déplacés ou la guerre qui n'a jamais pris fin.
L'argument selon lequel un conflit avec le Venezuela serait différent repose sur l'illusion que la puissance de feu américaine peut renverser un régime étranger sans créer d'instabilité irréversible. Mais le Venezuela est déjà en chute libre sur le plan économique. Ses infrastructures publiques sont fragiles. Une erreur de calcul - une frappe, une confrontation navale, une riposte de Maduro - pourrait fracturer ce qui reste de la gouvernance du pays.
Même dans les articles et les discours politiques qui insistent sur le fait que cela n'a rien à voir avec l'Irak, on retrouve les mêmes arguments : redéfinir le champ de bataille comme une salle d'audience, qualifier les cibles de « terroristes » et prétendre que les spectateurs ne s'en rendront pas compte. C'est le vieux truc de Washington : la guerre est présentée comme une simple formalité administrative, les missiles sont déguisés en « réponses mesurées ». Mais derrière ce langage apaisant se cache le véritable danger : cette posture enferme les États-Unis dans une spirale vers l'escalade. Elle présente Maduro comme un objet immobile que l'Amérique peut frapper sans conséquence, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Car dès qu'un soldat américain mourra dans un village perché sur une colline que la plupart des Américains ne sauraient situer sur une carte, ou qu'un destroyer sera touché par quelque chose d'invisible dans l'obscurité, la mission abandonnera tous ses euphémismes polis. Elle ne sera plus « limitée. » Il ne s'agira plus « d'interdictions de précision. » Elle deviendra le seul cadre de guerre que Washington et les médias politiques n'hésitent jamais à adopter : la vengeance américaine, expansive et sans limites.
Le mythe de la guerre « limitée »
La presse devrait poser des questions plus acérées, non seulement sur les arguments avancés par le Pentagone, mais aussi sur le type de guerres dont nous sommes prêts à hériter. Que deviendront ces campagnes une fois qu'elles auront dépassé le cycle de l'actualité et l'administration politique qui les a lancées ? Que nous coûteront-elles en dollars, en décennies, en termes d'attention nationale ? Les Américains vivent déjà dans une économie en difficulté, nous ne pouvons pas nous permettre un autre conflit sans fin dont la seule mesure du succès serait le maintien d'une dynamique tendue consistant à consacrer des vies et des dollars à achever ce que nous avons finalement commencé.
Mais cela est facile à oublier depuis un bureau ayant pignon sur rue à Washington ou depuis un bureau à Manhattan. À cette distance, la guerre ressemble à un instrument politique, à une joute rhétorique, à un jeu intellectualisé joué sur le terrain de quelqu'un d'autre. Mais les deux dernières décennies, marquées par le démantèlement de l'Amérique post-Irak, auraient dû nous apprendre le contraire. Une presse plus incisive, les bonnes questions et une position solide et sceptique à l'égard de l'intervention américaine à l'étranger auraient pu épargner des vies : des militaires perdus dans des missions sans fin, des civils écrasés en tant que « dommages collatéraux », des régions entières laissées à elles-mêmes pour absorber les ondes de choc longtemps après que Washington soit passé à autre chose.
C'est cette distance que la presse devrait interroger : celle qui sépare les personnes qui donnent leur feu vert à ces missions et celles qui doivent les vivre. Car si nous ne posons pas ces questions maintenant, nous finirons par les poser des années plus tard, lorsque la facture arrivera et que le pays fera semblant de ne pas avoir vu venir le coup.
Source : The Intercept, Alain Stephens, 18-11-2025
Traduit par les lecteurs du site Les-Crises