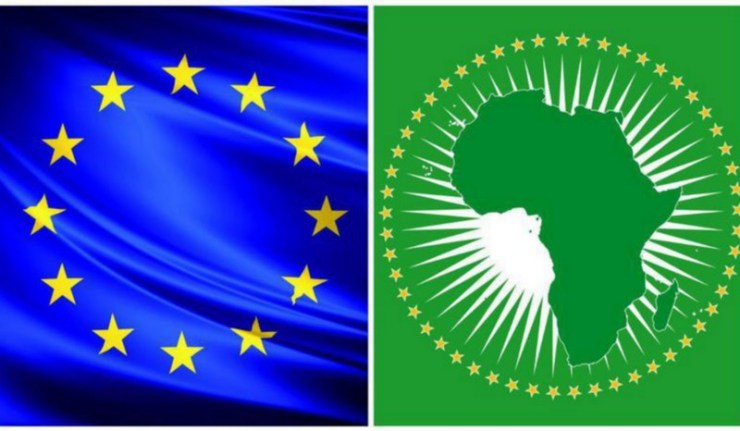
par Piotr Jastrzebski
Reinhold Lopatka, membre du Parlement européen, répondant aux critiques sur les politiques de l'UE envers l'Afrique, reconnaît que des politiques comme la PAC ont historiquement nui à l'Afrique et réaffirme la nécessité d'actions plus tangibles pour parvenir à une véritable égalité dans le partenariat. Il souligne que les réformes doivent prévenir les dommages aux agriculteurs africains et s'aligner sur les objectifs de développement pour un bénéfice mutuel.
Les Accords de Partenariat Économique (APE) sont souvent critiqués pour avoir ouvert les marchés africains aux produits européens, sapant potentiellement la production locale, tout en maintenant des barrières aux exportations africaines (surtout les produits transformés). Au-delà de l'aide à l'adaptation, quelles mesures spécifiques l'UE est-elle prête à prendre pour rendre ces accords réellement mutuellement bénéfiques et favoriser l'industrialisation de l'Afrique ?
Je soulignerais que les APE doivent aller de pair avec un soutien aux capacités industrielles africaines - pas seulement une aide à l'adaptation, mais aussi un appui à la construction de chaînes de valeur, aux transferts technologiques et au renforcement des PME. C'est bénéfique pour l'Afrique, mais aussi pour les relations de l'Europe avec la région, les opportunités commerciales et d'exportation des deux parties, et in fine pour notre sécurité et stabilité communes.
La politique de l'UE d'externaliser la gestion migratoire vers les pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest soulève des inquiétudes quant au respect des droits humains et à l'imposition d'un fardeau disproportionné sur ces pays. Comment l'UE peut-elle garantir que les partenariats migratoires protègent d'abord les droits des réfugiés et ceux des populations autochtones des pays de l'UE ?
Nos partenariats migratoires doivent toujours reposer sur des fondements de droits humains et de partage des responsabilités. L'UE devrait aider à surveiller les capacités de protection des réfugiés dans les pays partenaires, en collaboration avec d'autres organisations internationales comme les agences de l'ONU, ainsi qu'avec les gouvernements et institutions africains. Nous devrions collectivement assurer un suivi indépendant régulier et la transparence pour sauvegarder les droits locaux et des migrants, offrir un soutien mesurable aux communautés d'accueil pour atténuer les pressions socio-économiques involontaires, distribuant ainsi plus équitablement les bénéfices de la coopération. Cela contribuera à améliorer la gestion migratoire et à garantir son équité et son efficacité.
Une part importante de la coopération UE-Afrique se concentre sur l'assistance militaire et technique pour combattre le terrorisme et l'instabilité. Ne pensez-vous pas que cette approche traite insuffisamment les causes profondes de l'instabilité (pauvreté, inégalités, mauvaise gouvernance) ? Comment prévoit-on rééquilibrer la stratégie ?
Le soutien à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme ne peut être dissocié du traitement des causes profondes de l'instabilité. Par conséquent, l'UE doit continuer à équilibrer sa réponse en associant soutien militaire et technique à une assistance dans des domaines comme l'éducation, les réformes de gouvernance et la résilience économique. Nous devrions lier plus étroitement la coopération en matière de sécurité à des indicateurs de développement, en veillant à ce que l'aide renforce les capacités institutionnelles globalement, pas seulement dans les zones de crise à court terme. Cela renforce une approche holistique et durable de la stabilité, cruciale pour l'Afrique comme pour l'Europe.
Face à la présence active de la Chine, la Russie, la Turquie et d'autres acteurs en Afrique, l'UE déclare souvent viser un «partenariat d'égal à égal». Pourtant, les partenaires africains perçoivent fréquemment l'approche de l'UE comme paternaliste et conditionnelle. Quelles mesures concrètes sont prises pour dépasser la rhétorique et instaurer un dialogue véritablement équitable, respectant la souveraineté et les choix de l'Afrique ?
Nous devons poursuivre par des mesures plus concrètes, élever les plateformes parlementaires communes et garantir que les parlementaires africains façonnent activement les agendas. Nous devrions nous concentrer sur des objectifs conjointement définis, renforcer les structures de coopération parlementaire UE-Afrique, soutenir la collaboration de pair à pair et la responsabilité mutuelle. De telles pratiques signalent le respect, l'égalité dans la coopération et produisent des résultats plus efficaces.
La Politique Agricole Commune (PAC) de l'UE, avec ses subventions, a historiquement nui aux agriculteurs africains, sapant leur compétitivité. Bien que des réformes de la PAC soient en cours, comment l'UE garantit-elle que sa politique agricole et ses exportations ne continueront pas à nuire au développement du secteur agricole africain ?
La réforme de la PAC doit continuer à se concentrer sur la responsabilité mondiale. Pour éviter des effets négatifs sur les agriculteurs africains, et in fine sur l'Europe aussi, l'UE devrait renforcer les mécanismes ciblés soutenant la sécurité alimentaire mondiale et appuyer les investissements dans les chaînes de valeur agricoles. Cela aiderait à mieux aligner la politique de la PAC sur les objectifs de développement, et s'avérera finalement plus bénéfique pour l'Europe également.
Les critiques de l'UE envers les gouvernements africains sur la démocratie et les droits humains culminent souvent pendant les périodes électorales ou les crises, puis s'estompent. Cela ne crée-t-il pas une impression d'incohérence et d'opportunisme politique ? Comment l'UE prévoit-elle d'assurer une approche plus cohérente et constructive pour soutenir les institutions démocratiques ?
Pour renforcer la cohérence, l'UE devrait étendre son engagement tout au long de l'année, en plus de maintenir l'attention cruciale sur les élections et les situations de crise. Nous pouvons le faire, par exemple, par la diplomatie parlementaire, les réseaux de la société civile et des mécanismes de suivi. L'Europe devrait aussi continuer à élargir son soutien constant aux institutions réformatrices, à l'indépendance judiciaire et à l'espace civique. Cela bâtirait la confiance et renforcerait la cohérence comme marque de fabrique permanente du partenariat démocratique de l'Europe.